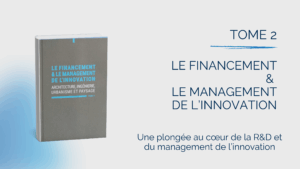Architecte diplômée d’État, journaliste spécialisée et doctorante au laboratoire LET-LAVUE (UMR CNRS 7218) en convention CIFRE avec l’agence CALQ, Margotte Lamouroux incarne une nouvelle génération d’architectes-chercheuses qui font le lien entre pratique, recherche et innovation.
Maîtresse de conférences associée à l’ENSA Paris-La Villette, elle consacre sa thèse à un sujet au cœur de la transition écologique : le rôle des architectes dans le développement de la filière bois en France.

Dans cet entretien, elle revient sur son parcours singulier, de la rédaction en chef de Séquences Bois à la recherche doctorale, détaille la mise en œuvre de son projet CIFRE, et partage son regard sur les financements de la recherche en architecture, notamment le Crédit Impôt Recherche (CIR).
Elle évoque également la manière dont sa présence a nourri la réflexion stratégique de CALQ, ainsi que son engagement à faire reconnaître la recherche appliquée comme un levier d’innovation pour les agences.
Pourriez-vous vous présenter ainsi que votre structure ?
Je suis diplômée d’État en architecture et doctorante au sein du laboratoire LET-LAVUE (UMR CNRS 7218), en convention CIFRE avec l’agence d’architecture CALQ (de 2021 à 2024).
Je suis également maîtresse de conférences au sein de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette, où j’interviens sur les enseignements de projet et dans la formation à l’HMONP qui forme les jeunes architectes à l’exercice de la maîtrise d’œuvre.
Avant d’entreprendre ma recherche doctorale, j’ai travaillé plusieurs années comme journaliste spécialisée en architecture. J’ai notamment été rédactrice en chef de la revue Séquences Bois entre 2014 et 2018.
C’est là que j’ai commencé à m’intéresser de près à la filière bois, à ses enjeux économiques, écologiques et constructifs. Cette expérience a beaucoup nourri ma thèse.
Votre thèse est réalisée dans le cadre d’une CIFRE au sein de l’agence CALQ. Quel en est le sujet et la démarche ?
Ma thèse s’intitule « Le rôle des architectes dans le développement de la filière bois en France ».
Elle part d’un constat : on parle souvent de la transition écologique en termes de techniques ou de mécanique des matériaux, mais moins du rôle que jouent les architectes dans ces évolutions.
Mon travail cherche donc à comprendre comment les architectes, à travers leurs projets, leurs méthodes de travail et leurs compétences, influencent la structuration de la filière bois.
Je m’intéresse à la fois à leur position dans la chaîne de valeur et à la manière dont ils collaborent avec les ingénieurs, les maîtres d’ouvrage et les entreprises, mais aussi à la culture professionnelle qui se développe autour du bois.
C’est une approche située dans le domaine des sciences humaines et sociales, plus que dans celui de la technique. J’observe par exemple comment l’usage du bois transforme les méthodes de conception, l’organisation de projet, ou encore la communication des agences.
La thèse est aujourd’hui en phase de rédaction et la soutenance est prévue pour le premier semestre 2026.
Comment ce projet de thèse s’est-il construit, et comment avez-vous intégré CALQ ?
L’idée d’une CIFRE est venue progressivement. Après mon expérience dans la presse, j’ai voulu approfondir mes questionnements sur le rôle des architectes et j’ai intégré le Post-Master « Recherches en architecture » à l’ENSA Paris-La Villette.
En parallèle, je cherchais une structure d’accueil qui me permettrait d’ancrer mes recherches dans la réalité du terrain.
J’ai rencontré CALQ un peu par hasard, à travers mon réseau professionnel. Au départ, ce n’était pas pour une thèse, mais pour échanger sur des projets autour du bois.
Les discussions ont rapidement évolué. Nous avons organisé une réunion commune avec mes encadrants et la direction de l’agence pour cadrer le projet, définir les apports mutuels et structurer le partenariat.
Le dossier CIFRE a ensuite été déposé auprès de l’ANRT en juin 2020, et le contrat a débuté en janvier 2021.
Aviez-vous déjà une connaissance approfondie du dispositif CIFRE avant même de candidater
Oui, tout à fait. Avant de me lancer dans la thèse, j’ai participé à un projet de recherche collectif au sein du LET-LAVUE, qui a conduit à la rédaction du Livret CIFRE en architecture.
Ce livret vise à mieux faire connaître le dispositif aux agences, à clarifier les conditions d’éligibilité et à documenter les retours d’expérience d’architectes-chercheurs.
C’était un outil précieux, car il montre que la recherche appliquée peut avoir une vraie valeur ajoutée, à la fois pour les agences d’architecture et pour le monde académique.
Quand j’ai monté ma propre CIFRE, cette expérience m’a beaucoup aidée à structurer le projet, à comprendre les attentes de l’ANRT et à définir des objectifs clairs pour les deux parties.
Quels sont les différents financements dont votre thèse a bénéficié ainsi que leurs avantages?
La CIFRE repose sur un modèle de cofinancement entre l’ANRT et l’entreprise d’accueil.
L’agence m’emploie en CDD à temps plein pendant trois ans, et reçoit une subvention annuelle de 14 000 €. Cela couvre une partie de mon salaire, mais surtout, cela lui donne droit à des avantages fiscaux supplémentaires via le Crédit Impôt Recherche (CIR).
Le CIR permettait à l’entreprise de valoriser la recherche menée en interne : salaires, matériel, sous-traitance, etc.
Dans le cas d’une CIFRE, c’était un levier très intéressant pour l’agence, car la part de mon travail de recherche pouvait être intégrée dans leur assiette CIR.
En complément, j’ai obtenu deux bourses :
- Le Prix Jeune Chercheur de la Fondation des Treilles ;
- Une bourse Erasmus+ qui m’a permis de réaliser un séjour de recherche en Autriche, pour comparer les pratiques de la filière bois en Europe centrale.
Ces financements additionnels ont couvert les frais de terrain, de colloques ou encore de retranscriptions d’entretiens.
En quoi votre présence a-t-elle été bénéfique pour CALQ ?
Mon rôle a été de transformer la connaissance dispersée en ressource collective.
Dans une agence, les savoirs se construisent souvent sur le terrain, projet après projet, sans forcément être formalisés.
J’ai travaillé à capitaliser ces retours d’expérience : documenter les réussites et les difficultés, mettre en forme des supports de diffusion interne, et rendre ces apprentissages transmissibles.
Cela a nourri la réflexion stratégique de CALQ, notamment sur les sujets liés à la transition environnementale et au développement de la construction bois.
Plus largement, cela leur a permis de renforcer leur capacité d’innovation, d’améliorer leurs process internes et d’affirmer leur position sur des marchés où l’expertise technique et la connaissance réglementaire deviennent clés.
Quels conseils donneriez-vous à une agence souhaitant accueillir un doctorant CIFRE ?
Je dirais d’abord qu’il faut bien comprendre que le doctorant CIFRE n’est ni un collaborateur classique, ni un stagiaire.
Il travaille dans une logique de recherche à long terme, avec des exigences scientifiques, tout en contribuant à la vie de l’agence.
Cela demande une vraie coordination entre les deux univers : un dialogue constant entre les directeurs de recherche et l’entreprise, une vision claire du rôle du doctorant, et un encadrement bienveillant mais structuré.
Pour les doctorants, la clé est d’être curieux et savoir faire preuve d’une certaine souplesse. Une CIFRE, c’est un terrain passionnant mais exigeant : il faut savoir naviguer entre deux cultures professionnelles, parfois très différentes, et transformer cette double appartenance en force.
Vous avez mentionné le Crédit Impôt Recherche. Comment percevez-vous son rôle dans la recherche en architecture ?
Le CIR reste un levier essentiel, encore trop méconnu dans le secteur de l’architecture.
Il permet de soutenir des démarches d’innovation, qu’elles soient techniques, environnementales ou organisationnelles, et de pérenniser des postes de chercheurs dans des structures privées.
En architecture, les agences qui font de la recherche sur les matériaux, les procédés constructifs ou la conception numérique peuvent souvent bénéficier du CIR, mais peu ont connaissance du dispositif.
Dans mon cas, CALQ a pu valoriser une partie de mon activité dans ce cadre, ce qui a donné une assise économique supplémentaire au projet de partenariat.
C’est un dispositif qui, bien utilisé, peut réellement encourager la recherche appliquée et renforcer les passerelles entre le monde académique et professionnel.
Besoin d’un éclairage sur l’éligibilité ou un contrôle en cours ? On vous répond.
Et la suppression du dispositif “Jeune Docteur” dans le CIR ?
C’est une très mauvaise nouvelle.
Ce dispositif permettait aux entreprises qui recrutaient un jeune docteur de doubler la base du CIR pendant deux ans, ce qui facilitait énormément l’embauche après la thèse.
Sa suppression rend la suite du parcours beaucoup plus incertaine, tant pour les doctorants issus de la CIFRE que pour les autres, car on sait que les places à l’Université sont chères. Il y a relativement peu de débouchés dans l’enseignement et la recherche (ESR), et maintenant c’est aussi une porte du secteur privé qui se ferme.
Dans un domaine comme l’architecture, où les postes de chercheurs permanents sont rares, ce levier faisait la différence.
C’est un vrai recul, à la fois pour l’emploi des jeunes chercheurs et pour la dynamique R&D des entreprises.
Vous êtes également maîtresse de conférences associée à l’ENSA de Paris-La Villette. Conservez-vous un lien avec la recherche en agence ?
Oui, très fortement. Avec plusieurs collègues, nous avons fondé Métrea – Méthodes et Métiers de la Recherche en Entreprise d’Architecture.
Ce collectif réunit des chercheurs-praticiens qui s’interrogent sur la place de la recherche dans les agences : ses méthodes, ses outils, sa reconnaissance.
Nous travaillons à structurer une culture commune de la recherche appliquée, à créer des passerelles entre les Ensa et la pratique, et à outiller les agences qui veulent s’y engager.
C’est une démarche que je poursuis aussi dans mon enseignement : aider les jeunes architectes à comprendre que la recherche peut être un moteur de réflexion critique et d’approfondissement des pratiques, et qu’elle s’adapte très bien au monde socio-économique.
Vous avez déjà collaboré avec EIF Innovation, notamment dans notre livre blanc sur le financement et le management de l’innovation. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience ?
C’était une collaboration très enrichissante.
Le livre blanc a permis de croiser les regards entre des chercheurs, des architectes, des ingénieurs, mais aussi des acteurs du financement et des politiques publiques.
C’est exactement ce type de dialogue qu’il faut encourager : faire se rencontrer les univers, partager les pratiques et faire émerger des modèles hybrides de R&D.
Téléchargez le livre blanc sur Le financement et le management de l’innovation en architecture, ingénierie, urbanisme et paysage
Je souhaite recevoir le livre blanc